Les vélos et équipements utilisés chez les coureurs professionnels sont aujourd’hui à la pointe de ce que des technologies en constante évolution peuvent offrir. Au point que le matériel semble plus efficace que jamais si l’on en croit l’avis de nombreux coureurs, même si son importance reste à relativiser selon le terrain ou les circonstances de course.
Par Guillaume Judas – Photos : depositphotos.com

« Aujourd’hui, on a des vélos tellement rapides que si tu es vraiment collé à la roue du mec de devant, tu ne pédales presque pas », soulignait Romain Bardet dans l’Equipe du 26 avril 2022. Un constat déjà avancé par Maxime Bouet dans Ouest France du 11 octobre 2021 : « Le vélo, c’est devenu comme de la F1, où vous avez tout qui est maîtrisé et optimisé dans le but d’améliorer la performance. » Ces histoires de vélos rapides interrogent, tant ils semblent désormais indispensables à la réalisation de bons résultats en compétition. Pour certains observateurs, cette idée ne serait pourtant que le fruit d’un discours marketing savamment distillé par les fabricants de vélos haut de gamme, ou une allégation de l’entourage des coureurs pour dissimuler des pratiques inavouables.
Pourtant, depuis l’invention des courses cyclistes à la fin du XIXe siècle, le matériel utilisé par les coureurs n’a cessé d’évoluer au gré des améliorations techniques proposées par l’industrie. Mais c’est à partir de la fin des années 80 que des choix audacieux ont permis de marquer des différences significatives en matière de performances, d’abord sur les épreuves contre la montre comme avec le fameux guidon de triathlète utilisé par Greg Lemond sur le Tour de France 1989 remporté pour huit secondes au détriment de Laurent Fignon. Cette année-là, le Tour comportait 136 km de chrono (en trois étapes). L’avantage du guidon utilisé par l’Américain était déjà estimé à deux secondes par kilomètre par rapport au poste de pilotage en forme de corne de vache utilisé par le Français. Dans le même temps, les pédales automatiques se généralisaient, en apportant un gros avantage pour le confort et la sécurité des coureurs, juste avant le lancement au début des années 90 des changements de vitesse intégrés aux poignées de frein. Après 50 ans d’une très lente évolution depuis l’apparition du dérailleur dans les années 30, le matériel cycliste faisait un bond en avant spectaculaire en quelques années seulement.
La révolution carbone
Dix ans plus tard, les cadres en carbone ont commencé à se généraliser et à devenir la norme grâce à de nouveaux procédés de fabrication, qui ont permis de produire de nouvelles formes de tubes, en gagnant du poids et de la rigidité. « En 2003, nous avons lancé notre premier cadre route en carbone avec l’Orca, qui correspondait exactement au comportement routier qu’on souhaitait lui donner, commence Joseba Arizaga, chef produit route chez la marque basque Orbea. À l’époque, notre équipe phare était la formation Euskaltel-Euskadi avec de grands grimpeurs comme Iban Mayo, Samuel Sanchez, Roberto Laiseka, Haimar Zubeldia, ou Egoï Martinez. On souhaitait un cadre réactif, nerveux et surtout léger. Ça a été le début de deux décennies d’innovations, grâce aux évolutions des technologies de fabrication. Désormais, nous sommes capables de réaliser des choses impensables il y a encore dix ans, en termes de forme et d’épaisseur des tubes par exemple, tout en assurant la rigidité et la fiabilité voulues. Et nous en sommes à la septième génération de l’Orca. »
Pour Philippe Gilbert, professionnel de 2003 à 2022, champion du monde en 2012 et vainqueur de quatre Monuments sur cinq, consultant pour L’Equipe et Eurosport le carbone a permis de produire des roues plus performantes, avant d’élever franchement le niveau des cadres : « En 2003, nous utilisions encore des jantes en aluminium avec 36 rayons pour les Classiques pavées. Puis l’équipe CSC et son leader Fabian Cancellara ont commencé à utiliser des jantes hautes en carbone, plus aérodynamiques, quel que soit le parcours. À l’époque, nos vélos étaient déjà très légers, mais les cadres n’étaient pas encore aérodynamiques, il y avait tous les câbles qui dépassaient. Depuis, les vélos n’ont pas cessé de gagner de l’efficacité. C’est peut-être peu sensible pour les cyclotouristes, mais pour des pros qui évoluent souvent à plus de 50 km/h, l’influence du matériel est très importante. »
Un constat également partagé chez les amateurs, avec des moyennes qui augmentent au fil des ans. « Après quelques années en Elite, j’ai couru pendant 20 ans en deuxième et troisième catégorie, témoigne Anthony Supiot, 51 ans et coureur amateur dans les Pays-de-Loire. Depuis quatre ou cinq ans, je vois que sur les mêmes courses et les mêmes circuits et dans la même catégorie, les moyennes augmentent. Bien sûr, je prends de l’âge, mais les données du compteur ne trompent pas, et ça s’accélère surtout depuis quatre ou cinq ans, depuis l’apparition d’une nouvelle catégorie de vélos, plus aérodynamique, avec des freins à disque et beaucoup d’intégrations. »

Rester dans la course
« L’évolution du matériel est constante, reprend Philippe Gilbert. Il y a quelques années, il fallait une remise à niveau tous les trois ans environ, mais je dirais qu’aujourd’hui, chaque année, ça va de plus en plus vite. Parfois, ça peut même poser des problèmes d’équité en compétition, avec des marques plus en avance que d’autres. C’est quelque chose que j’ai ressenti, en me faisant parfois sortir de l’aspiration dans les descentes ou faux plats descendants, derrière des coureurs d’une équipe avec des vélos clairement plus efficaces. On peut constater le même phénomène sur les épreuves contre la montre, où dans les classements on voit les mêmes équipes avec trois ou quatre modèles de vélos qui sortent du lot. »
« Sur les épreuves contre la montre, dans les classements on voit les mêmes équipes avec trois ou quatre modèles de vélos qui sortent du lot » – Philippe Gilbert
« Nous sommes obligés de chercher à innover tout le temps dans les moindres détails, car si nous ne faisons que suivre, on est vite largués », avance pour sa part le Slovène Gorazd Štangelj, directeur sportif chez Bahrain Victorious, dans un reportage diffusé par Eurosport sur Youtube fin juin 2023. Avec le Danois Martin Toft Madsen, ancien pro et consultant en aérodynamique et matériel pour son équipe, Štangelj a piloté un test comparatif entre des vélos et équipements de 1989 (un vélo Carrera en acier semblable à celui de Claudio Chiapucci) de 2003 (un Cannondale de l’équipe Saeco semblable à celui de Gilberto Simoni), de 2012 (un Pinarello de l’équipe Movistar d’Alejandro Valverde) et donc de 2023 avec le Merida Scultura utilisé par Bahrain Victorious. Sonny Colbrelli, ancien vainqueur de Paris-Roubaix, a servi de cobaye et a enchaîné les rotations avec les quatre machines, en roulant à 300 watts sur le plat et en montée. « Sur le plat, nous voyons une différence de deux km/h entre le vélo de 1989 et celui de 2023, pour la même puissance développée, précise Martin Toft Madsen. Et la même chose en montée. Mais ce qui est intéressant, c’est que sur le plat il y a peu de différence entre le vélo de 89 et celui de 2012, mais qu’ensuite l’écart se creuse entre 2012 et 2023. En montée par contre, l’écart principal se creuse entre 89 et 2003, et ensuite les vélos sont très proches. Mais c’est assez logique car le gain de poids principal sur les vélos a été obtenu au tout début des années 2000. »
« L’argument de l’efficacité du matériel est recevable, mais dans certaines conditions, tempère Frédéric Porteleau, ingénieur en mécanique des fluides et qui a conçu une méthode de calcul indirect de la puissance développée, afin de comparer les performances des coureurs d’une génération à l’autre. Par exemple, il est indéniable que pour le Record de l’Heure, les gains aérodynamiques apportés par le matériel ont eu une influence très importante. Mais si on veut comparer le record de Filippo Ganna (56,792 km en octobre 2022) avec celui d’Eddy Merckx 50 ans plus tôt (49,431 km), on doit aussi souligner que l’Italien est un pur rouleur spécialiste de la piste, quand le champion belge était un routier complet qui a battu le record à l’issue d’une saison bien remplie. D’un autre côté, Ganna a battu le record au niveau de la mer contrairement à Merckx, et il doit même pouvoir faire un peu mieux en altitude. » En montagne, là où Porteleau peut effectuer des calculs précis en tenant compte de la pente, du revêtement, du poids du matériel et des coureurs, il estime que les gains sont vraiment minimes. « Le poids des vélos a peu évolué depuis 20 ans, et on en reste toujours à la limite UCI de 6,8 kg. On ne peut pas descendre en dessous. En montagne, c’est le facteur le plus important. L’amélioration du matériel a donc une faible influence dans un col, surtout sur une route en mauvais état. Sans doute qu’avec les gros progrès réalisés sur les pneumatiques ces dernières années, on a pu économiser cinq watts à faible vitesse mais pas plus. »
« L’évolution la plus importante à laquelle j’ai assisté au cours de ma carrière, c’est l’apparition des dérailleurs électroniques. » – Haimar Zubeldia
Haimar Zubeldia, professionnel de 1998 à 2017 et deux fois cinquième du Tour de France (en 2003 et en 2007) nous indique pourtant que de son point de vue, « l’évolution la plus importante à laquelle j’ai assisté au cours de ma carrière, c’est l’apparition des dérailleurs électroniques. Avant, en étant à bloc dans un col, on économisait inconsciemment nos changements de braquet, car ça demandait un léger effort de concentration ou pour pousser sur le câble de la manette. Avec l’électronique, il n’y a plus à se soucier des croisements de chaîne, ou de la fiabilité des passages de pignons et appuyer sur un bouton demande toujours la même faible impulsion. Pour moi, dans un col, ça compte ! » Une évolution des transmissions aussi mise en avant par Philippe Gilbert : « En 20 ans de carrière, je suis passé de 9 à 12 vitesses à l’arrière. Il y avait toujours le pignon qui manquait, et ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et on parle peu de l’énorme évolution des braquets, qui aide à produire de la vitesse dès la moindre descente. Un de mes anciens coéquipiers, Victor Campenaerts roule maintenant souvent avec un développement de 58/11, voire 60/11, ou vous avez par exemple des coureurs de la Jumbo-Visma comme Tiesj Benoot qui utilisent un 54/10, alors que personnellement j’ai fait l’essentiel de ma carrière avec 53/11. »

Toujours plus haut
Pour suivre l’évolution du matériel et même en être directement les instigatrices, les marques de cycles et les équipes pros travaillent souvent de concert. Pour des raisons de stratégie interne, Orbea s’est éloignée du World Tour, mais reste présente en Continentale Pro avec Lotto Dstny et Euskaltel-Euskadi, et chez les femmes avec Ceratizit-WNT. « Les exigences de performance sont les mêmes, reprend Joseba Arizaga, et pour une marque comme nous qui vend 400 000 unités par an, depuis le vélo enfant jusqu’au vélo de pro en passant par le VTT électrique, suivre les évolutions technologiques et continuer de progresser est essentiel. Lorsqu’un concurrent sort un nouveau modèle, nous l’examinons sous tous les angles, nous le comparons, et nous essayons de faire mieux dans les domaines de l’aérodynamique, du gain de poids, de la rigidité et du comportement global du vélo. Nous avons aussi nos propres objectifs, selon les remontées de terrain que nous avons des pratiquants. Nous utilisons des outils informatiques de simulation très évolués, nous travaillons en soufflerie, et nous avons aussi des moyens de mesure sur le terrain. Et toutes les grandes marques procèdent de la sorte. »

Sébastien Servet, chef du bureau d’étude route et Gravel chez Specialized, la marque qui équipe Soudal-Quick Step, Bora-Hansgrohe et SD Worx va même plus loin : « Au-delà de la conception du matériel, nous disposons pour notre part d’un département nommé Ride Science, dont le travail est de collecter un maximum de données avec la télémétrie, puis de pratiquer des simulations en fonction des parcours et des conditions météo, et ensuite de conseiller les équipes qui roulent avec notre matériel. Et c’est bien sûr à partir de ces données que nous savons dans quelle direction nous lancer pour concevoir un nouveau produit. » Comme dans toutes les équipes, la marque entretient aussi des relations privilégiées avec certains coureurs reconnus pour leur finesse d’analyse, comme Kasper Asgreen ou Yves Lampaert chez Soudal-Quick Step, qui selon Sébastien Servet « sont souvent en relation avec nos ingénieurs et testent de nouvelles choses ou combinaisons d’équipements, car leurs retours sont très pertinents. »
Une somme de gains marginaux
Les vertus attribuées au matériel seraient ainsi un peu plus complexes à définir que le lancement d’un nouveau cadre ou d’une nouvelle paire de roues au comportement miraculeux. « En 20 ans de carrière chez les pros, j’ai vu le matériel évoluer bien sûr, poursuit Haimar Zubeldia, mais à mon sens il n’est pas le seul responsable des gains de vitesse que l’on constate aujourd’hui sur toutes les courses. L’arrivée de Sky dans le cyclisme professionnel à la fin des années 2000 a tiré toutes les performances vers le haut. En quelques années, nous nous sommes tous mis à chasser les gains marginaux. Sur mes premiers Tours de France, on mangeait ce qu’il y avait à l’hôtel. Puis on est arrivés avec nos pâtes, puis avec notre cuisinier, et maintenant de nombreuses équipes ont même leur camion-cuisine garé sur le parking. Le gain de performances obtenu avec le matériel suit cette tendance. » « On s’est tous moqués de Sky, au début, avec leurs capteurs de puissance, leurs stages en altitude, leurs cuisiniers, tout ça…, souligne pour sa part Maxime Bouet dans Ouest France. Mais en fait, regardez, on a tous fini par faire comme eux avec cinq ou dix ans de retard. Et on a bien vu que ça avait des incidences sur les performances. Les gains marginaux, ça existe et on a tous voulu aller vers ça, à notre manière. Gagner un petit watt par ci, par là… »

Le matériel évoluerait finalement en même temps que les méthodes d’entrainement, la micro-nutrition, ou l’équipement vestimentaire, ce qui expliquerait logiquement une augmentation globale des performances. « Dans tous les gains aérodynamiques constatés ces dernières années, on peut aussi attribuer une part d’au moins 20 % à la tenue et au casque, insiste Sébastien Servet. Tous les coureurs ou presque roulent aujourd’hui en course avec une combinaison, parce qu’on sait que sur un maillot le moindre pli coûte énormément. »
Des stratégies perturbées
Tout semble donc indiquer que c’est avant tout sur le plat et dans les descentes que le matériel aurait permis les plus gros gains de vitesse, et donc de vitesse moyenne. Les autres améliorations semblent moins spectaculaires. Pour quelles conséquences ? D’abord une prise de risque supplémentaire pour les coureurs, dans certaines phases de course. Le 17 juin 2023, au lendemain de la chute mortelle de Gino Mäder dans la descente du col de l’Albula à la fin de la cinquième étape du Tour de Suisse, Jean-François Bernard, troisième du Tour de France 1987 et consultant pour FranceInfo, soulignait au micro de la radio française la vitesse atteinte par les coureurs dans certaines situations. « Il y a de plus en plus d’enjeux sur les courses, les vélos vont plus vite et il y a les freins à disque (qui sont censés offrir plus de sécurité, NDLR)… », comme pour mettre en évidence que les nouvelles technologies poussaient parfois à rouler au-delà des limites.
Mais l’augmentation des vitesses moyennes modifie également les stratégies des équipes. Les fins de course sont de plus en plus rapides, et les coureurs sont de plus en plus proches physiquement les uns des autres. Il est quasiment impossible désormais pour un homme seul de sortir d’un peloton à quelques encablures de l’arrivée. « L’amélioration du matériel et l’optimisation de tous les facteurs liés à la performance ont indéniablement permis d’augmenter la vitesse générale du peloton, conclut Haimar Zubeldia. Nous assistons à un nivellement par le haut de l’ensemble des coureurs. Mais paradoxalement, cette évolution pousse les grands champions à se dévoiler plus tôt en course, à tenter des choses bien plus loin de l’arrivée. Et finalement, c’est le spectacle qui en sort gagnant. »

Partager la publication "Enquête : les vélos modernes sont-ils vraiment plus rapides ?"



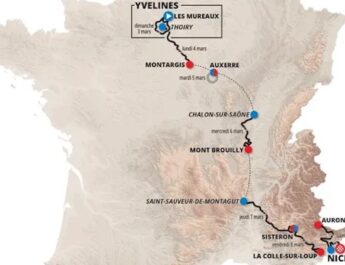
Honnêtement je possède 2 giant tcr pro 1 identique cadre groupe ,l’un en disc et tubless l’autre à patin et à boyaux…..pour la course le vélo à patin ultegra monté avec des roues dura ACE c35 boyaux veloflex reste selon moi meilleurs……par contre j’apprécie le tubless à l’entraînement pour son côté sans soucis et les disc pour rouler sous la pluie……